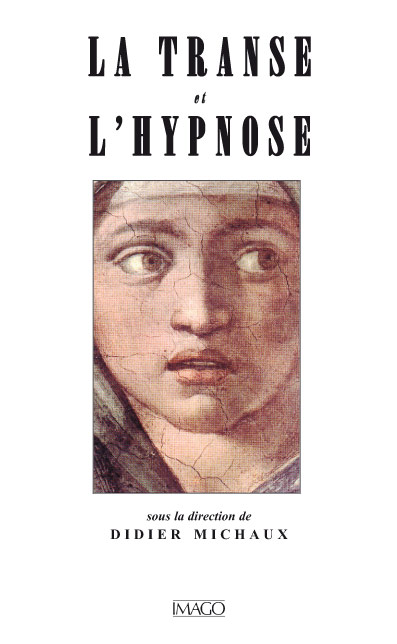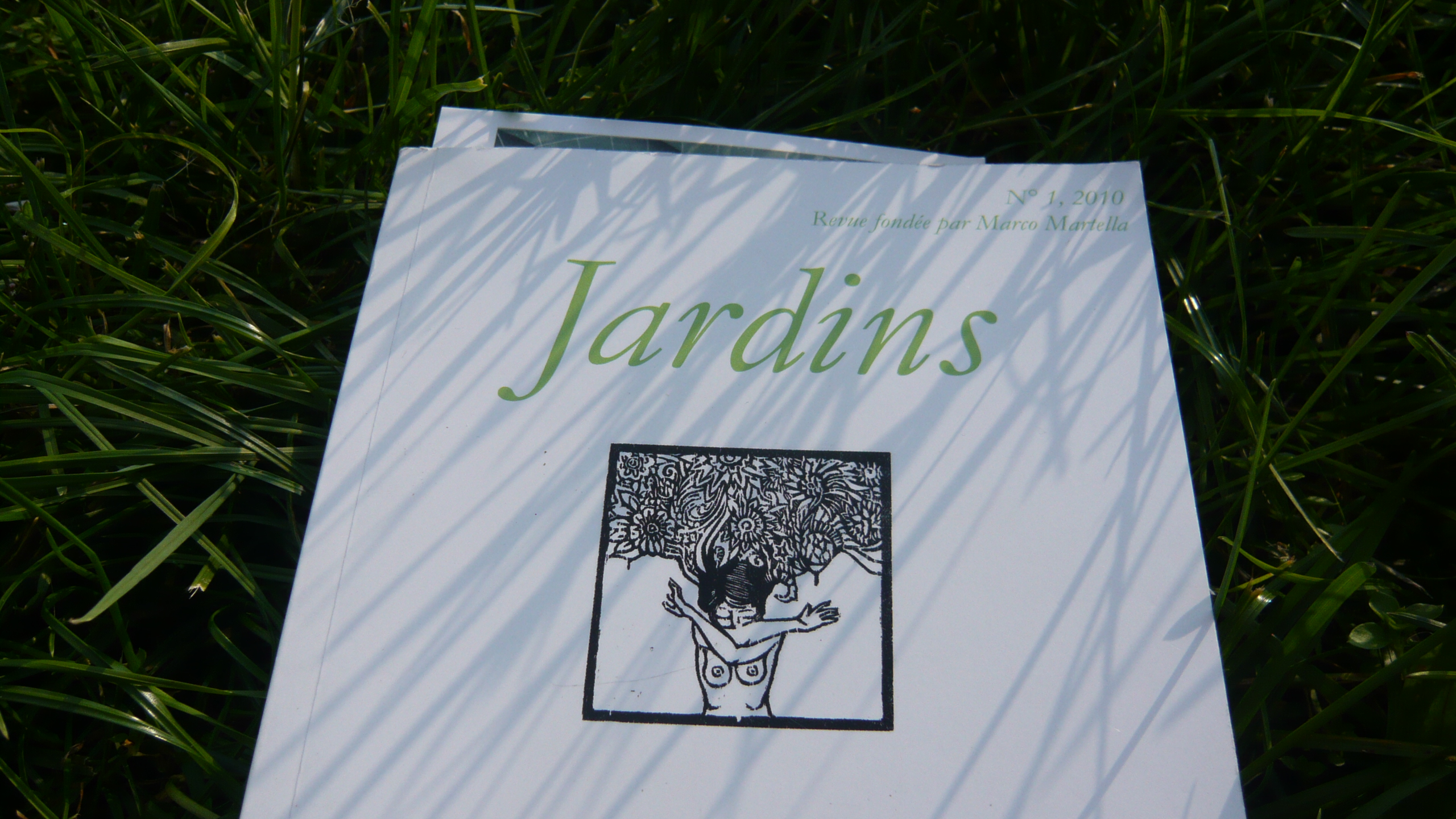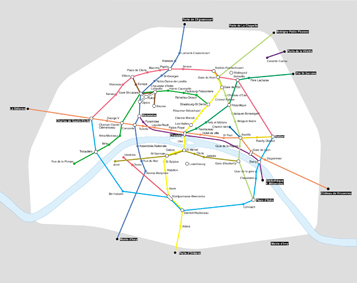“Into Eternity” est un documentaire particulièrement intéressant sur Onkalo, un lieu, une structure, une oeuvre de génie civil et un sanctuaire pensé pour durer au moins 100 000 ans, au sud-ouest de la Finlande.
Son objectif ? Etre une cachette, une cavité (onkalo en finnois) autonome, stable et protégée de toute intrusion humaine future où les déchets radioactifs pourront être stockés.
Le chantier a commencé en 2004 et peut durer jusqu’à deux siècles. Bienvenue à Onkalo, tombeau du feu et de l’énergie de notre civilisation, que nos enfants devront “se souvenir d’oublier”.
“Into eternity” est un documentaire de Michael Madsen que rediffuse Arte cette semaine, et qui jette une nouvelle lumière sur le sujet des déchets nucléaires, de leur gestion et de la communication dont il est l’objet.
Le documentaire présente Onkalo, un site d’enfouissement de très long terme actuellement en construction en Finlande, où les roches se sont montrées jusqu’à présent suffisamment stables dans de très longues périodes pour être envisagées comme un endroit potentiellement stable, en termes géologiques, dans le futur.
Ce site expérimental, pensé pour prendre la relève des solutions temporaires de stockage actuelles, a été peu médiatisé jusqu’à présent : les ressources francophones sur le sujet sont peu nombreuses, et si plusieurs d’entre nous ont bien une vague idée, depuis quelques années, que ce type de projet puisse être a l’étude, sa communication institutionnelle et sa présence médiatique a été a ce jour marginale.
Le documentaire du réalisateur Michael Madsen est, à ce jour, le seul qui existe sur le sujet du traitement des déchets a très long terme et pose des questions philosophiques concrètes, réelles, sur ce qui sera probablement le seul sanctuaire que nous laisserons de notre civilisation sur une échelle de temps que notre entendement n’est pas en mesure de visualiser.
Comment garantir, dès lors, l’harmonie du projet avec son environnement, et surtout de protéger les humains qui vivront sur terre de ce lieu hautement radioactif où les sens que nous, êtres humains, avons développé (la vue, l’odorat, le toucher, l’ouïe, le goût) ne sont pas en mesure de d’établir ni d’en mesurer le possible danger ? Et comment rendre le lieu entièrement autonome ? Ingénieurs, politiciens, théologiens mais aussi les techniciens, les ouvriers du chantier sont tour à tour interrogés.
Le sujet implique une réflexion où tout doit être envisagé : ce que nous savons savoir, ce que nous savons ne pas savoir, et ce que nous ignorons ignorer. Dans 100 000 ans, notre civilisation n’existera plus, la géographie et la géo-politique auront changé, et tout l’enjeu des concepteurs du projet, et de ceux qui le valident et le portent au niveau politique est, au delà du défi technique, un véritable vortex philosophique.
En effet, comment d’abord assumer un tel leg immémorial, mais surtout en tenir les humains d’alors éloignés ? Comment communiquer ? Quels seront alors les connaissances, le savoir technique, culturel qui pourront permettre d’indiquer aux générations futures de s’en tenir éloignés ?
Si les politiques penchent pour l’installation de “marqueurs” qui signifieront le site par des pierres runiques par exemple, gravées de messages en différentes langues et pictogrammes, comment s’assurer qu’ils seront compris ? Les langues, les symboles changent, l’espèce humaine aussi.
Après un âge de glace qui peut être particulièrement fatal en terme d’équilibre naturel et de survie de l’espèce humaine, poussant nos paysages en toundra, l’homme tel que nous le connaissons sera-t-il le même ? Aura-t-il les mêmes sens ? Des capacités intellectuelles, techniques, proches des nôtres ? Pourra-t-il comprendre ce qu’il se passe exactement a cet endroit là ?
Le message à passer doit se réduire, selon les chercheurs en charge du projet, a quelque chose d’extrêmement général. Ce n’est pas un endroit important, c’est un endroit de danger, éloignez vous : tels sont les point qui se doivent d’être communiqués.
Mais l’homme tel que nous le connaissons est curieux par nature et lors de la découverte de “marqueurs” de civilisations antérieures, comme les Pyramides d’Egypte (qui, en comparaison, ne datent “que” de 5000 ans), ont été autant d’invitations a mener des fouilles a ces endroit précis, et certains messages de sanctuaires de civilisations antérieures n’ont toujours pas été décryptés.
Le casse-tête est réel : comment proposer un message qui marche intuitivement, et indique de façon universelle que le lieu est inhospitalier ? Fait intéressant : les acteurs du projet se sont penchés à titre d’observation, sur la peinture “Le cri” d’Edward Munch, et réfléchissent autour de cette représentation, à la façon technique, architecturale et symbolique d’exprime la négativité de cet espace, de cet emplacement.
Etablir des marqueurs en surface du site implique d’attirer l’attention alors que tout l’objectif des ingénieurs et des concepteurs est d’éviter à tout prix l’intrusion humaine. Nous ne savons pas, en 2011, comment pourraient être interprétés les déchets et le lieu. Trésor, tombeau, sanctuaire ?
La construction d’un tel site, creusé jusqu’à 500 mètres dans le sol et prévu pour être comblé, hermétiquement refermé par des dépôts, a été aussi pensé comme barrière technologique. Un décisionnaire du projet s’explique : si l’espèce humaine a alors, la technologie qui permette de creuser, elle aura alors sûrement aussi des connaissances sur la radioactivité.
Mais, même dans ce cas là, qui peut nous dire que les capsules ne seront pas, alors, considérées comme des matières rares et précieuses, pouvant servir par exemple de monnaie d’échange? Ou des objets de culte et de vénération ? Comment imaginer le comportement de l’homme d’alors, et le protéger des déchets de notre civilisation énergétique d’aujourd’hui ? Comment signifier ce lieu absolument autre ?
Onkalo, lieu hétérotopique de l’énergie ?
L’hétérotopie (du grec topos, “lieu” et hétéro, “autre” : “lieu autre” est un concept forgé par le philosophe Michel Foucault. Le terme a d’abord été employé pour la première fois par Foucault dans la préface de Les Mots et les choses, Une archéologie des sciences humaines (Gallimard, 1966) à propos d’un texte de Jorge Luis Borges («La Langue analytique de John Wilkins», Enquêtes, 1952, Gallimard, 1957) puis, dans une intervention sur France Culture du 21 décembre 1966 («Les Hétérotopies», Le Corps utopique de Les Hétérotopies, Lignes, 2009), et enfin dans sa conférence prononcée le 14 mai 1967 à l’invitation d’Ionel Schein devant le Cercle d’études architecturales dont le texte, qui est devenu l’expression canonique de la pensée de Foucault quant à la notion d’hétérotopie, a été publié seulement en 1984 («Des espaces autres»).
Lieux de localisations physiques de l’utopie, mais aussi de la mise a l’écart, ce sont des lieux a l’intérieur d’une société qui en constituent le négatif, ou sont en marge (cimetières, coins de jardin, cabanes, asiles…). Selon Michel Foucault, toute culture présente des hétérotopies : “c’est là une constante de tout groupe humain” dit-il, mais il n’y a pas une forme d’hétérotopie qui soit absolument universelle. Il définit six critères permettant une description systématique des hétérotopies comme “espaces autres” :
– Les hétérotopies sont présentes dans toute culture,
– une même hétérotopie peut voir sa fonction différer dans le temps,
– l’hétérotopie peut juxtaposer en un seul lieu plusieurs espaces eux-mêmes incompatibles dans l’espace réel,
– au sein d’une hétérotopie existe une hétérochronie, à savoir une rupture avec le temps réel,
– l’hétérotopie peut s’ouvrir et se fermer, ce qui à la fois l’isole, la rend accessible et pénétrable.
– les hétérotopies ont une fonction par rapport aux autres espaces des sociétés : elle sont soit des espaces d’illusion soit des espaces des perfection.
Bâti, pensé pour exister sur une durée qui dépasse tout entendement, dont la fonction ou tout du moins la fonction symbolique évoluera de même que l’intégration géologique, Onkalo se pose comme espace, et donc objet, hétérotopique et hétérochrone.
Réponse de “moindre mal” à un problème déjà réel, déjà là, qui est celui des déchets nucléaires que nous produisons, le projet d’Onkalo est une métaphore vertigineuse, bien qu’enterrée, du paradoxe que peut représenter l’énergie pour notre civilisation. Nécessaire à toute entreprise humaine, l’énergie est plus que jamais un outil de développement, mais aussi d’échanges, de commerce, d’information et de connaissances.
L’énergie est, fondamentalement, la capacité d’un système à modifier un état, à produire un travail en entraînant un mouvement, de la lumière ou de la chaleur. Dans sa définition physique, l’énergie ne peut ni se créer ni disparaître, mais uniquement se transformer d’une forme à une autre (principe de Mayer) où être échangée d’un système à l’autre (principe de Carnot). C’est le principe de conservation de l’énergie.
Mais c’est à partir de la Révolution industrielle que le concept physique d’énergie s’est affirmé pour devenir central de notre civilisation, posant les questions de l’approvisionnement, du stockage et du transport de l’énergie, mais aussi de ses déchets, comme préoccupations majeures de nos sociétés.
La découverte de la radioactivité est également très récentes, et date aujourd’hui d’à peine plus d’un siècle. Si la radioactivité existe a l’état naturel, l’activité humaine est devenue l’un des principaux agents de rayonnements ionisants, principalement par les activités médicales, mais aussi les industries minières, centrales au charbon, l’armée, l’énergie nucléaire civile, les accidents de centrales, et la recherche.
La connaissance de la radioactivité permet également une approche du temps que nous n’avions pas pu avoir auparavant par l’usage du radiocarbone, c’est à dire l’isotope 14 du carbone, qui permet une datation de bonne précision des objets organiques dont l’âge ne dépasse pas 50 000 ans.
Par la science et la recherche, nous avons pu être en mesure d’avoir une appréhension et un rapport différent au temps, en utilisant le radiocarbone mais aussi la connaissance de l’atome en général. Une échelle, une appréciation nouvelle a pu être établie mais elle reste malgré tout sans commune mesure avec les au moins 100 000 années que doit être effectif le projet Onkalo, et le fait que nous ne pouvons qu’avoir une image extrêmement vague ou figurée d’un possible futur, mais aucune carte en main pour l’envisager sur une telle portée.
Le temps, également, est un corollaire de la notion de mouvement, le temps suppose de la variation. Onkalo porte la diachronie de notre rapport actuel a l’énergie et par là l’antériorité et la postériorité. Si le temps est une expérience universelle, Onkalo est une représentation réelle, concrète, creusée, qui nous met face à notre difficulté a approcher le temps comme concept, et va au-delà de notre compréhension intuitive des nombres et des unités, mais aussi notre manque de connaissance, encore, sur la véritable durée de vie du cycle d’intégration des déchets radioactifs que nous ne produisons que depuis peu.
Lieu absolument autre, envers de notre civilisation énergétique, Onkalo nécessite de l’intuition de la part de ses concepteurs : les sens, notre expérience et nos connaissances actuelles ne peuvent pas nous renseigner absolument sur ce que peut être le site dans 100 000 ans et l’état, la situation de la planète alors.
Si l’autonomie du lieu comme oeuvre de génie civil peut s’avérer réelle, son autonomie comme hétérotopie l’est moins. En effet, selon Jean-Claude Moineau, théoricien de l’art et professeur émérite de l’Université de Paris VIII, les hétérotopies constituent pour Foucault non tant des espaces ou des lieux que des « emplacements » qui, loin de toute autonomie, sont en liaison, sont en relation de voisinage au sens topologique sinon de proximité géographique avec tous les autres.
Les “emplacements” hétérotopiques communiquent avec tous les emplacements « réels », qui, tels des miroirs, les « reflètent » tous en même temps qu’ils les « contestent » et les inversent, établissant comme un court-circuit entre réel et irréel.
Bien qu’effectivement localisable, Onkalo est iréel : notre réel contemporain ne nous donne pas suffisamment de moyens pour envisager sa réalité sur une telle durée. Le message d’Areva, dans sa publicité, l’est tout autant, mais de manière dangereuse, par “virtualité décalée” comme le notait Gildas Bonnel, fondateur de l’agense Sidièse et membre du collectif de communication responsable “Adwiser.”
A l’inverse des politiques qui souhaitent monter un centre d’archives et d’information sur le site dont les générations futures auraient pour mission d’actualiser le langage, les chercheurs du projet Onkalo envisagent la constitution d’une légende, d’un mythe, comme média d’information sur le très long terme sur le site.
Ils proposent de présenter Onkalo comme lieu dont il est important de se “souvenir d’oublier.” Leur recherche de la métaphore ultime, d’un message suffisamment fort pour être intuitivement compris pendant au moins 100 000 années fait entrer la littérature et la fiction dans la danse macabre entre nos besoins en énergie et le danger pour nos descendants.
Voilà un défi que Jorge Luis Borges, avec sa culture phénoménale des mythes et légendes et sa capacité a en créer, aurait sûrement aimé relever, et dont la philosophie contemporaine et les humanités devraient, peut-être, davantage se soucier.
- Michael Madsen, “Into eternity” (Danemark, 2010, 75mn)
- Une version de l’article sur Rue89
Vidéos :
Bibliographie :
- Michel Foucault “Le corps utopique, les hétérotopies” (Nouvelles Editions Lignes, 2009, postface de Daniel Defert)
- Jean-Claude Moineau “Retour du futur. L’art à contre courant” (Editions ère, 2010)